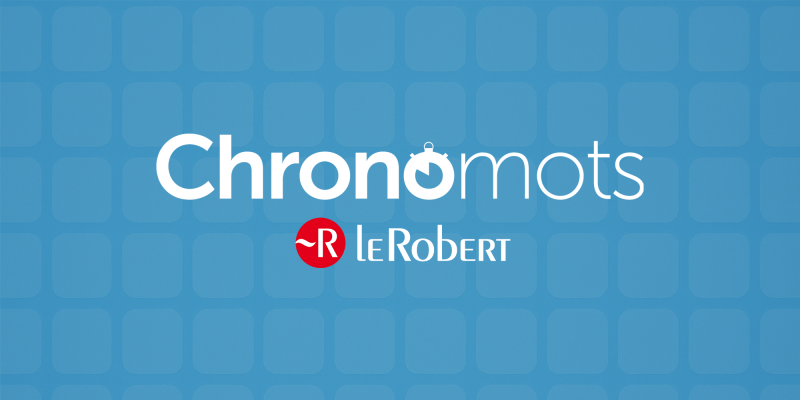vocatif
définition
exemples
Phrases avec le mot vocatif
Mais, en définitive, ne serait-ce pas l'usage lui-même du vocatif qui pose question ?L'Autre, 2013, Jean-Claude Métraux (Cairn.info)
Il est vrai que les grammairiens anciens ne parlent jamais d'un traitement accentuel différent dans tous ces vocatifs par rapport au reste du paradigme.Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, 2017, Éric Dieu (Cairn.info)
Ainsi, rien n'impose de tirer l'accentuation de ces deux vocatifs de celle du vocatif indo-européen.Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, 2017, Éric Dieu (Cairn.info)
Il fait suivre quatre vocatifs masculins pour rendre la séquence diuinae calidae et frigidae !Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, 2017, Jean Soubiran, V. Gitton-Ripoll (Cairn.info)
Mais, de bonne foi, je n'attachais aucune idée à ces vocatifs décousus.Honoré-Gabriel de Riqueti de Mirabeau (1749-1791)
Renforcée par l'usage du vocatif, cette forme d'expression contribue à la réactivation du chant, ou plus précisément des sentiments et des sensations qu'il recèle.Topique, 2014, Patrick Saurin (Cairn.info)
C'est que le vocatif joue un rôle spécifique dans le discours par rapport aux autres cas.Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, 2017, Éric Dieu (Cairn.info)
E. signe du vocatif, et quelquefois du pluriel dans les noms.Abbé Brasseur de Bourbourg (1814-1874)
À nouveau, le renoncement à l'usage du terme féminin dans l'emploi vocatif (lorsqu'on interpelle la personne) ne fait l'objet d'aucune explication.Allemagne d'aujourd'hui, 2021, Nathalie Schnitzer (Cairn.info)
Mais une autre raison plus générale invite à penser que l'accent de πάτερ remonte exclusivement à celui des vocatifs toniques de l'indo-européen.Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, 2017, Éric Dieu (Cairn.info)
L'emploi de l'article montre bien qu'il s'agit simplement d'un syntagme détaché, apte à qualifier le destinataire de l'injonction, et non d'un vocatif.Revue de philologie de littérature et d'histoire anciennes, 2007, Camille Denizot (Cairn.info)
L'effet d'attente ainsi créé permet de mettre en relief l'élément rejeté après l'adresse au vocatif.Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, 2014, Christine Mauduit (Cairn.info)
Cette influence exercée par le vocatif sur le reste de la flexion en attique se comprendrait aisément dans des termes pouvant servir d'insultes.Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, 2017, Éric Dieu (Cairn.info)
On emploie encore le vocatif pour introduire une proposition optative, ex.Études et documents berbères, 2019, Jean Delheure, Juan Antonio Ochoa, Ouahmi Ould-Braham (Cairn.info)
Notez bien le ton du discours : vocatif impérieux, qui ne laisse aucune place aux atermoiements.Multitudes, 2006, Régis Michel (Cairn.info)
Le vocatif est un cas grammatical qui exprime l'interpellation.Revue de didactologie des langues-cultures et de lexiculturologie, 2016, Jean-Michel Robert (Cairn.info)
Or le moment passionnel invite, dans l'urgence, à restaurer les droits du vocatif, du génitif et du datif.Cliniques méditerranéennes, 2004, Monique Schneider (Cairn.info)
Cependant, l'absence d'article (en cas de vocatif ou d'apostrophe) n'est pas systématique.Revue de didactologie des langues-cultures et de lexiculturologie, 2016, Jean-Michel Robert (Cairn.info)
Le recul de l'accent dans ces formes a donc chance d'être lié au vocatif.Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, 2017, Éric Dieu (Cairn.info)
Ces textes sont bien des adresses faites au lecteur, et on lit dans ces vocatifs une véritable rhétorique de l'apostrophe.Revue française d'études américaines, 2007, François Gavillon (Cairn.info)
Afficher toutRéduire
Ces exemples proviennent de sites partenaires externes. Ils sont sélectionnés automatiquement et ne font pas l'objet d'une relecture par les équipes du Robert. En savoir plus.
Dictionnaire universel de Furetière (1690)
Définition ancienne de VOCATIF s. m.
Terme de Grammaire. Cinquiéme cas de la declinaison des noms, dont on se sert, quand on veut appeller quelqu'un.
Ces définitions du XVIIe siècle, qui montrent l'évolution de la langue et de l'orthographe françaises au cours des siècles, doivent être replacées dans le contexte historique et sociétal dans lequel elles ont été rédigées. Elles ne reflètent pas l'opinion du Robert ni de ses équipes. En savoir plus.