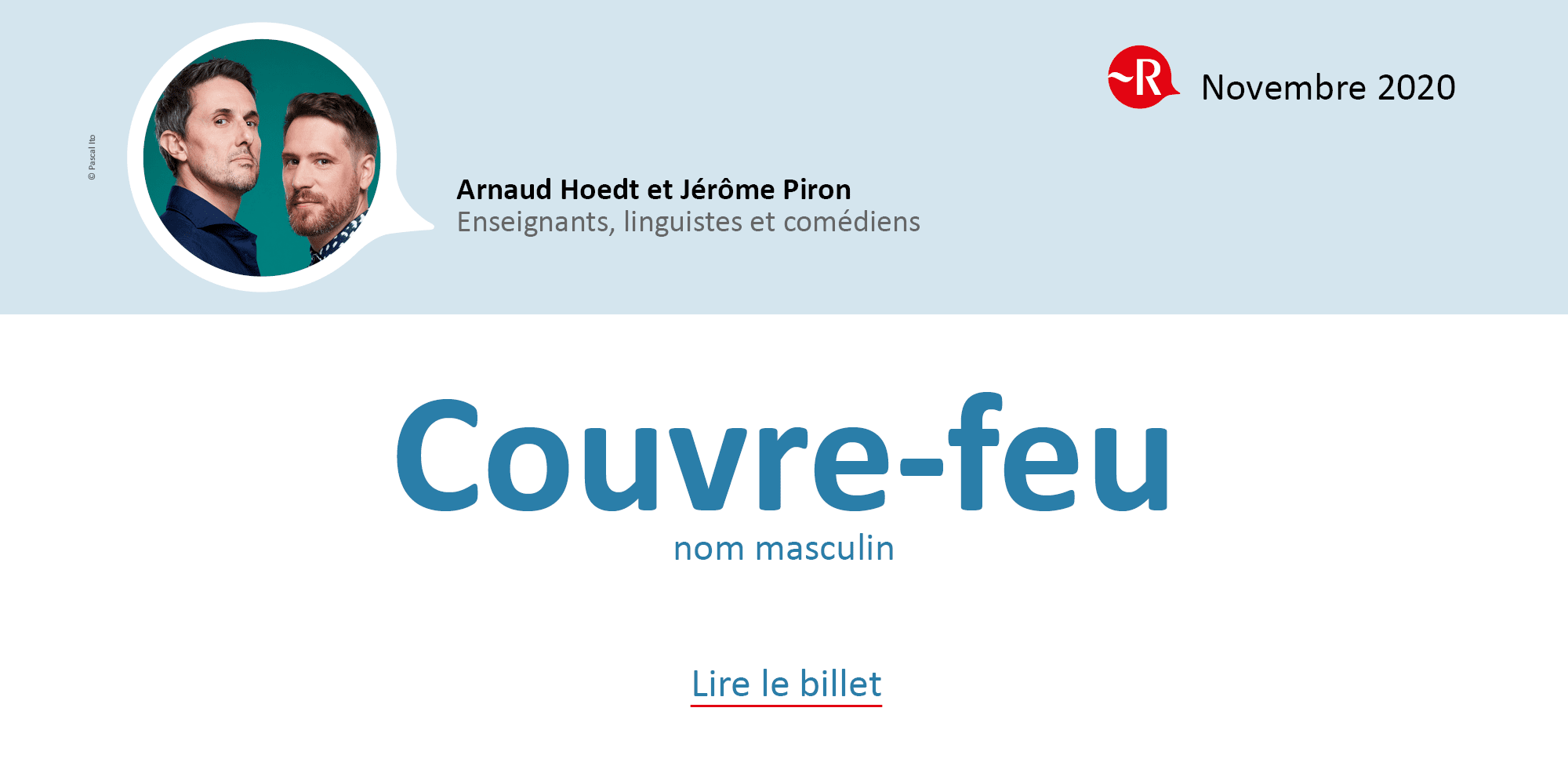
On peut écrire plusieurs types de billets sur la langue. Il y a d’abord ceux des passionnés, des exégètes, qui vous font goûter avec une verve jubilatoire les mille et une richesses truculentes de l’histoire d’un mot.
On y raconterait que le terme « couvre-feu » désignait une cloche que l’on sonnait au Moyen Âge pour ordonner aux gens de couvrir le feu de leur logis afin de protéger les habitations des incendies fréquents. Ces billets décrivent notre langue comme un incroyable catalogue d’accidents et de bifurcations toujours délectables et dont on peut remplir des collections entières (les mots de la guerre, les mots de l’amour, les mots de la cuisine, de la salle de bains, de la buanderie…) et les rayonnages des bouquinistes de seconde main, sans jamais lasser le lecteur friand de ces petits récits, souvent anecdotiques, mais toujours fascinants.
On peut aussi écrire des billets plus engagés, qui rappellent les implications politiques derrière l’utilisation d’un mot. On écrirait plutôt un truc du genre : « dès son apparition, le mot ‘‘couvre-feu’’ est employé sous le double signe de la protection et de la répression ». « For your own good », comme on dit en anglais. Couvrir vient en effet du latin co-operire, qui signifie protéger ou recouvrir entièrement, dissimuler. On recouvre à la fois pour faire disparaître, pour cacher au prétexte de protection du « foyer ». On ne manquerait pas dans ce billet de faire remarquer que le mot « couvre-feu » rappelle les heures les plus noires de la Seconde Guerre mondiale et qu’il a été théorisé en doctrine de la « guerre contre-révolutionnaire » par l’Armée française durant la bataille d’Alger, permettant ainsi d’arrêter, la nuit, des personnes soupçonnées de soutenir le FLN.
Bref, on peut souvent faire dire au passé ce qu’on veut dire du présent. Comme le disait plus ou moins Maslow : « Quand on a un marteau dans la tête, tout a la forme d’un clou ».
Nous, notre marteau à nous, c’est la question de l’orthographe française.
Quand on lit le mot « couvre-feu », la première chose qu’on se demande, c’est : « est-ce que c’est vraiment un mot ? ». Est-ce que ce n’est pas deux mots ? Voire carrément une petite phrase ? Parce qu’après tout : qu’est-ce qu’un mot ?
Ce qui nous intéresse, c’est comment ce mot est fait : un verbe (couvre) et son complément (feu), unis par un trait d'union. En français, et dans plein d’autres langues, c’est extrêmement fréquent : des groupes de mots s’agglutinent pour former un seul mot. On peut même affirmer, comme l’écrit Yves-Ferdinand Bouvier, que tous les « mécanismes syntaxiques engendrés par la grammaire universelle » produisent des mots, à partir d’un noyau, qu’on appelle aussi une tête. On peut le faire suivre d’un complément (l’âge d’or) ou le faire précéder (amérindien), lui coller une épithète, encore une fois devant (grand-place, autrefois) ou derrière (âge mûr ou vinaigre), ou encore, on peut coller deux noyaux coordonnés (chassé-croisé ou nœud-nœud). Quant aux natures des mots qu’on soude, c’est pareil, tout existe : deux noms (wagon-lit), un verbe et un nom (portemanteau, ayant droit), deux adjectifs (clair-obscur), un adverbe et un nom (avant-scène, plein emploi, entracte), deux prénoms (Yves-Ferdinand), etc.
Mais du coup, quand est-ce qu’un groupe de mots devient un mot ? Leur orthographe peut-elle nous éclairer ? Qu’est-ce qui préside à l’écriture des mots composés ? La simple lecture des exemples choisis plus haut suffira à vous faire comprendre qu’il faut bien avouer que c’est un peu le bordel (et on n’a même pas cité « presqu’ile »).
Dans notre spectacle La Convivialité ou la faute de l’orthographe, on s’amuse à expérimenter des trucs en direct. Nous proposons, entre autres, aux spectateurs une série de mots dont nous avons modifié l’orthographe et nous leur demandons s’ils accepteraient de les écrire de cette nouvelle manière. L’une de ces nouvelles graphies est la suivante : « quendiraton ». Immanquablement, son apparition provoque l'hilarité générale et cette orthographe est systématiquement rejetée. Or, on l’utilise bien comme un seul mot (on dit « LE qu’en-dira-t-on ») et il est répertorié comme « nom masculin » dans les dictionnaires. Pourtant, il existe à notre connaissance peu de propositions pour écrire un fait-néant ou des gens-d’arme.
Alors quand laisse-t-on des blancs, quand met-on un trait d’union et quand colle-t-on tout ?
En toute logique, il devrait s’agir des trois étapes successives de ce qu’on appelle une lexicalisation, c’est-à-dire la transformation en un mot. Mais dans la réalité… Prenons « compte rendu », « tire-bouchon » et « passeport ». Il semble très difficile d’affirmer que le dernier est « plus un mot » que le premier. Et la confusion est encore plus grande quand on s'interroge sur la manière d’accorder ces mots composés. Traditionnellement, le mot « couvre-feu » est invariable, il ne prend jamais de marque du pluriel. Pour expliquer cela, il faut faire un détour interprétatif qui pousse à considérer l’expression comme une proposition (« on couvre le feu »). Pour la même raison, « sèche-cheveux » devrait porter la marque du pluriel à « cheveu », même au singulier, sous prétexte qu’on sécherait plusieurs cheveux à la fois. À quoi il serait facile d’objecter qu’on ne se sert que d’un seul appareil pour y parvenir. Sans parler du fait que ce genre d’interprétation est souvent empreint de subjectivité (combien de dents suis-je en train de curer quand j’insère un bout de bois dans mon interstice dentaire ? Combien de feux dois-je couvrir dans mon foyer une fois que la cloche a sonné ?). Cette approche provoque une confusion sur la nature même de ce que l’on accorde : un mot composé n’est pas un syntagme. Un mot n’est pas une petite phrase. C’est pourquoi, la réforme de 1990 proposait logiquement de mettre une marque du pluriel à la fin des noms composés, et seulement au pluriel. Ainsi, grammaticalement, on considère un mot pour ce qu’il est.
Le regard des francophones sur l’orthographe est en train de changer. Elle n’est plus aussi sacrée ou « une et indivisible » qu’on l’imaginait dans le courant du XXe siècle et l’idée de l’améliorer n’est plus systématiquement condamnée. La distinction entre la langue et l’orthographe a fait son petit bonhomme de chemin et on comprend mieux aujourd’hui qu’on puisse réformer l’une sans attenter à l’autre. On pourrait imaginer mettre un peu d’ordre et de méthode dans ce grand tohubohu que sont les mots composés. On pourrait, par exemple, proposer, sans aucune modification de la langue orale, de rationaliser l’écriture de ces mots pour qu’ils répondent mieux à l’intuition sémantique qu’ils traduisent chez les locuteurs. On pourrait systématiser leur usage en fonction de ce que l’usager veut dire afin de soumettre le graphique (l’écriture) à la sémantique (le sens), et plus l’inverse.
Trois cas de figure se présentent alors à nous.
En cas d’absence totale de lexicalisation : lorsque le nom composé n’en est pas un et s’apparente à un syntagme ou à une petite proposition indépendante dans laquelle les éléments sont interchangeables avec d’autres sans aucune rupture grammaticale. Dans ce cas-ci, un simple blanc graphique serait requis : un ami fidèle, une petite fille ou encore une table basse (avec l’intention de marquer la différence avec une table d’une hauteur normale). Le pluriel serait marqué à chaque mot, comme l’exigent les règles de la grammaire française : des amis fidèles, des petites filles, des tables basses. Rien de bien folichon.
Ensuite, tous les noms composés dont le sens initial des parties reste perceptible par le locuteur, mais qui sont en voie de lexicalisation plus ou moins accomplie : un porte-cigarette, un cure-dent, une porte-fenêtre, une petite-fille (pour désigner la descendante de la grand-mère, quelle que soit sa taille) ou même une table-basse (dans son sens générique pour désigner l’objet spécifique auquel on consacre, par exemple, une rubrique dans un catalogue de meuble). Dans ce cas, on utiliserait un trait d’union. La règle unique pour former le pluriel, déjà proposée par la réforme de 1990, s’appliquerait à ces mots : une seule marque du pluriel en fin de mot, en toute logique. Ce qui donne « des porte-cigarettes », « des porte-fenêtres », « des wagon-lits », « des année-lumières »…
Enfin, les mots qui ont subi une lexicalisation complètement achevée, et dont le sens initial des parties nous échappe plus ou moins, comme « fainéant », « vermoulu » ou encore « verglas ». Pour ces mots, l’ensemble excède la somme des parties et on les utilise pour désigner des réalités clairement circonscrites. La marque du pluriel étant ici portée par le mot unique, en toute logique (des fainéants, des meubles vermoulus, des vinaigres). Nous en avons même emprunté à l’anglais en francisant leur prononciation, comme le mot « redingote » qui vient de « riding coat » ou paquebot qui vient de « packet boat ».
Cette perception étant parfois subjective, on pourrait même étendre la tolérance graphique au point de laisser les gens écrire « tirebouchon » ou « plancul » à l’envi. On percevrait alors dans ces tournures le fait que la personne désigne un objet unique, une unité lexicale fortement soudée, une entité sémantique homogène. On permettrait ainsi à l’usager de se réapproprier son outil linguistique et de faire primer ce qu’il veut dire sur la manière de l’écrire. Une table basse est souvent plus haute qu’une table-basse.
Il semblerait donc tout à fait logique d’écrire aujourd’hui, le « quendiraton », un « boutentrain » ou même « aujourdui » comme on écrit un « biscuit » (cuit deux fois) ou le « bonheur » (bonne chance).
On écrirait donc un « couvrefeu » et des « couvrefeux ».
La systématisation de ces règles permettrait, en outre, de faciliter leur enseignement. Les élèves n’auraient alors qu’à se demander ce qu’ils veulent dire et la manière de l’écrire en découlerait tout naturellement. Au lieu de cela, aujourd’hui, on leur fait retenir par cœur d’interminables listes d’exceptions et de graphies incohérentes aux explications alambiquées, voire, n’ayons pas peur des mots, sanqueuenitête.
Biblio :
Saint-Pierre, G. (s. d.). L’affaire des composés masqués., Revue web Correspondance, consulté 22 octobre 2020
Yves-Ferdinand Bouvier, Définir les composés par opposition aux syntagmes, consulté le 22 octobre 2020
Raemdonck, D. V. (2018). L’orthographe entre méforme et réforme, Synergies Pays germanophones n° 11 – 2018, p. 102. Site du GERFLINT, consulté le 22 octobre 2020
[Nouveauté !] Dans Le Français n’existe pas, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, deux comédiens belges - également linguistes de formation et professeurs de français - remettent en cause nos certitudes sur la langue française avec humour. À travers vingt et une chroniques diffusées pour la plupart sur France Inter, Hoedt et Piron dynamitent joyeusement poncifs et idées reçues sur « le bon usage » du français, en ouvrant le dialogue avec des chercheurs et des linguistes de tous horizons. Un ouvrage idéal pour réinventer notre rapport à la langue, avec humour et intelligence !




