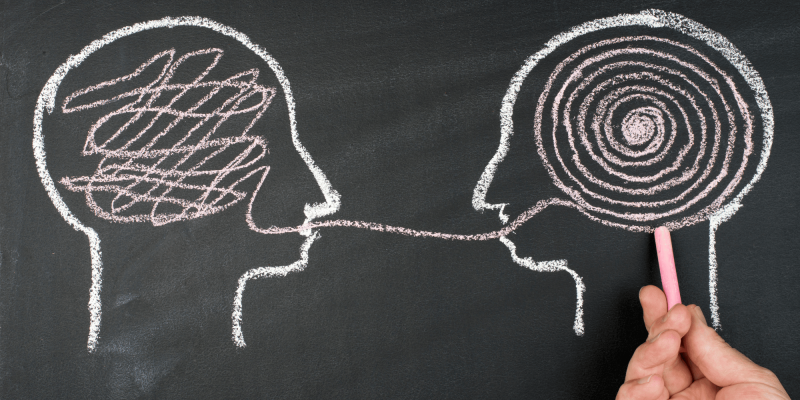
Ah, les intraduisibles ! Ils font vibrer les amoureux des langues… et donnent des sueurs froides aux traducteurs. Si on le prend au pied de la lettre, l’intraduisible, c’est ce qui ne peut être traduit. Il s’oppose au traduisible, son contraire. L’intraduisible impliquerait alors l’impossibilité de passer d’une langue à l’autre. En théorie. Car en pratique, les choses sont (toujours) un peu plus complexes.
Il ne faut pas prendre l’intraduisible dans son sens littéral. Techniquement, tout se traduit et on le fait depuis longtemps. Plus que l’impossibilité de traduire, il s’agit surtout d’une impossibilité de définir de façon succincte, de convertir de manière fidèle et satisfaisante en français un concept qui tient en un mot dans une autre langue. Ces termes révèlent des nuances culturelles et des visions du monde que certains peuples ont choisi d’introduire dans leur vocabulaire.
Maintenant que nous sommes au point sur ce que recouvre le concept, partons à la découverte de ces trésors linguistiques avec un top 10 des mots intraduisibles en français, du japonais au portugais en passant par l’allemand !
10. komorebi (japonais)
Imaginez-vous sous un arbre par une belle journée d’été. Les rayons du soleil filtrent à travers les feuilles, créant un jeu d’ombre et de lumière qui vous hypnotise. Les Japonais ont un mot pour ça : komorebi, littéralement composé de ko (arbre), de more (filtrer) et de bi (soleil). En français, nous pourrions parler de lumière filtrée ou de jeu d’ombres, mais cela manque cruellement de précision poétique.
9. Waldeinsamkeit (allemand)
Les germanophones, maîtres incontestés des mots-valises, nous offrent Waldeinsamkeit en allemand : cette sensation de solitude paisible que l’on ressent seul dans une forêt. Composé de Wald (forêt) et d’Einsamkeit (solitude), ce terme romantique évoque une communion spirituelle avec la nature, une solitude choisie et régénératrice. En français, nous tournerions autour de cette idée avec des expressions comme solitude sylvestre ou recueillement forestier.
8. saudade (portugais)
Voici peut-être l’un des mots les plus célèbres de notre sélection ! La saudade, en portugais, est un mélange de nostalgie, de mélancolie et de manque, souvent teinté d’une douce amertume. Ce sentiment peut concerner un être cher absent, un lieu quitté à contrecœur ou un bonheur passé. Ni tout à fait de la tristesse, ni de la nostalgie pure, la saudade est une émotion à part entière, si vive dans la culture lusophone qu’elle imprègne le fado et toute une tradition artistique. Nous pouvons la décrire ou l’expliquer, mais la réduire à un seul mot français ? Mission impossible. C’est d’ailleurs pour cette raison que le mot est référencé dans le Petit Robert !
7. hygge (danois)
Ce concept danois désigne l’art de créer une ambiance chaleureuse et conviviale, où règnent le bien-être et la satisfaction simple. Devenu un véritable phénomène marketing, au point de faire son entrée dans l’édition 2020 du Petit Robert, le hygge ne saurait toutefois se réduire aux bougies parfumées et aux plaids douillets. Un dîner entre amis, une soirée cocooning, un moment devant la cheminée quand il neige... Le hygge, c’est la philosophie du bonheur à la scandinave : accessible, authentique et sans prétention.
6. Schadenfreude (allemand)
Encore un trésor linguistique de la langue allemande ! La Schadenfreude qualifie cette joie un brin malicieuse que l’on ressent en observant le malheur d’autrui. Composé de Schaden (dommage) et de Freude (joie), ce mot met le doigt sur un aspect peu reluisant mais bien réel de la nature humaine. Qui n’a jamais ressenti un petit frisson de satisfaction en voyant son rival trébucher (métaphoriquement ou non) ? Les Allemands ont eu l’honnêteté d’en faire un mot.
5. Fernweh (allemand)
Le mot Fernweh décrit la nostalgie du lointain, y compris de lieux où l’on n’est jamais allé ; une envie profonde de voyager vers l’inconnu, en somme. C’est l’opposé du Heimweh (mal du pays) : au lieu de languir après son chez-soi, on se met à fantasmer d’ailleurs. En français, nous parlons d’envie de voyager ou de soif d’aventure, mais le Fernweh évoque quelque chose de presque existentiel pour incarner cette fièvre du voyage qui nous prend devant une carte du monde ou un documentaire sur des contrées à l’autre bout de la planète. Décidément, l’allemand excelle dans l’art de nommer nos états d’âme sans détour !
4. sobremesa (espagnol)
Après un bon repas, que fait-on ? On reste à table pour papoter, digérer, refaire le monde ! Les Espagnols ont baptisé ce moment sobremesa (littéralement « sur la table »). C’est cet art de prolonger le plaisir du repas par la conversation, ces instants où l’on reste attablé bien après avoir fini de manger, juste pour le plaisir d’être ensemble.
3. gökotta (suédois)
Voici un mot qui ravira les lève-tôt ! Gökotta renvoie au fait de se lever aux aurores pour aller écouter le chant des oiseaux, notamment au printemps. Cette tradition suédoise mêle l’amour de la nature et la recherche de sérénité matinale. Un rituel de retour aux sources avant tout le monde si vous préférez.
2. mamihlapinatapai (yagan)
Mamihlapinatapai est un mot de la langue yagan (parlée en Patagonie) qui décrit le regard complice entre deux personnes qui désirent faire quelque chose sans oser prendre l’initiative. C’est ce moment suspendu où deux timides se regardent en espérant secrètement que l’autre fera le premier pas. Ce mot illustre parfaitement ces micro-situations humaines universelles que certaines langues choisissent de cristalliser en un terme unique. En français ? Nous sommes condamnés aux périphrases encore une fois : regard complice d’hésitation mutuelle ou échange muet d’intentions communes, peut-être. Pas aussi poétique, avouons-le.
1. ubuntu (langues bantoues)
Ubuntu est une notion humaniste africaine que l’on retrouve dans toutes les langues bantoues (le mot bantou voulant dire « personnes »), comme le xhosa, le zoulou, le swati ou encore le swahili. Si on analyse sa structure, le mot est formé à partir d’un préfixe réservé aux noms abstraits (ubu-) et d’un radical désignant l’être humain (-ntu). On peut le rapprocher du français humanité, même si l’intention diffère. Ubuntu, c’est s’ouvrir à l’autre, parce qu’on a conscience d’appartenir à quelque chose de plus grand que soi-même. Nelson Mandela en avait fait l’un des piliers de la réconciliation post-apartheid en Afrique du Sud.
S’il fallait traduire ubuntu en français, on pourrait dire : « je suis ce que suis grâce à ce que nous sommes ensemble ». Quelle plus belle façon de clore ce top 10 des mots intraduisibles en français ?
Ces dix mots (et il en existe tant d’autres) nous rappellent que les langues ne sauraient être réduites à de simples outils de communication : elles prennent des dimensions culturelles qui révèlent comment chaque peuple perçoit et s’approprie le réel. Accueillir ces intraduisibles, c’est accepter de faire un pas de côté pour voir le monde autrement et en découvrir des facettes que notre propre langue avait peut-être négligées. Dès qu’on les apprivoise, ces mots intraduisibles en français finissent par trouver leur place dans notre cœur... et peut-être un jour dans nos dictionnaires ?
Crédit : marrio31 / iStock






