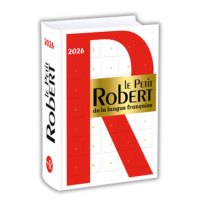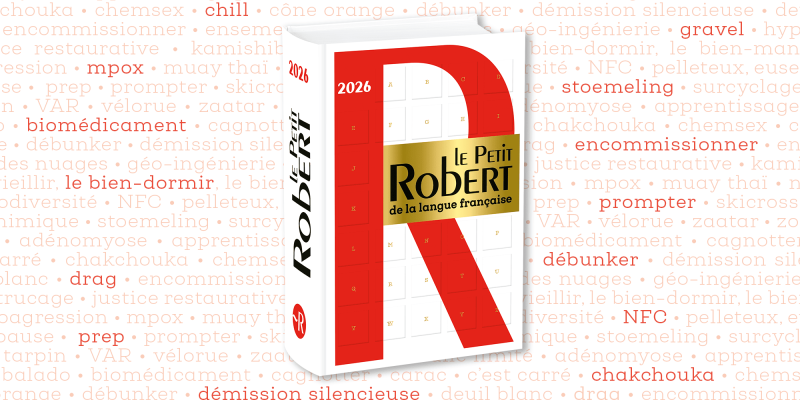
Quels sont les nouveaux mots, sens et expressions qui font cette année leur entrée dans le plus célèbre des dictionnaires ?
Découvrez l’histoire de dix néologismes parmi les 150 nouveautés de l’édition 2026 du Petit Robert de la langue française (parution mai 2025).
10. hypertrucage (ou deepfake)
Sans surprise, parmi les nouveaux entrants du Petit Robert se trouvent plusieurs termes liés à l’intelligence artificielle (IA), dont le vocabulaire se développe aussi rapidement que la technologie elle-même. On peut notamment citer apprentissage profond (deep learning), prompter, clonage de voix ou encore hypertrucage. Ce dernier terme, créé par l’Office québécois de la langue française pour concurrencer l’anglicisme deepfake, désigne le procédé de manipulation audiovisuelle permettant la création d’images, de vidéos ou d’audios truqués très réalistes ; une façon de faire dire n’importe quoi à n’importe qui.
Si l’anglicisme deepfake s’est répandu comme une traînée de poudre en raison de l’omniprésence du procédé, son synonyme français hypertrucage se fait également une place en français, et pas seulement au Québec. C’est notamment ce terme qui est employé dans la version française de la loi européenne sur l’intelligence artificielle de 2024 : « les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un hypertrucage [doivent indiquer] que les contenus ont été générés ou manipulés par une IA ».
9. surcyclage
Après le recyclage, voici le surcyclage. Surcycler, c’est réemployer des matériaux ou objets usagés pour fabriquer des produits de plus grande valeur, tandis que les produits recyclés sont, en général, considérés comme étant de valeur inférieure au produit initial (le papier recyclé est moins blanc, par exemple, que le papier non recyclé).
Le produit surcyclé peut être une œuvre artistique (par exemple une sculpture réalisée avec de la ferraille), un accessoire de luxe (un sac réalisé à partir de chutes de tissu) ou même un objet strictement utilitaire présentant des avantages par rapport au produit de départ, comme une durée de vie plus longue.
Si le concept n’est pas nouveau, le mot surcyclage est, lui, plutôt récent. Il naît en 2014 pour traduire le mot anglais upcycling, et connaît un usage croissant ces dernières années. D’autres mots ont pourtant été proposés par les organismes officiels de terminologie pour traduire upcycling : recyclage valorisant en France, suprarecyclage ou recyclage à gain de valeur au Québec (le préfixe supra- marque en effet davantage la qualité supérieure que le préfixe sur-, qui indique normalement une position supérieure dans le temps ou l’espace). Cependant, c’est sans conteste le terme surcyclage qui a gagné la bataille de l’usage, et par là même sa place dans le dictionnaire !
Citons quelques autres mots autour de la thématique du développement durable ou du climat qui font leur entrée dans le Petit Robert : géo-ingénierie, ensemencement des nuages, vélorue ou encore zone à trafic limité (ZTL).
8. mpox
Maladie infectieuse et contagieuse d’origine virale, forme atténuée de la variole, la mpox ne s’est pas toujours appelée ainsi. Découverte chez des singes (même si on l’a trouvée depuis chez d’autres animaux), elle est d’abord désignée par l’expression variole du singe (monkeypox en anglais). Problème : l’Organisation mondiale de la santé déconseille l’emploi de mots susceptibles de stigmatiser des régions géographiques, des groupes ethniques ou des espèces animales. Variole du singe devient donc tout simplement… mpox ! Une abréviation du terme anglais pas simple à prononcer en français (/èm-pox/). Quant à son genre, masculin ou féminin, les deux se rencontrent en proportion égale et sont donc acceptables.
Citons quelques autres mots des sciences qui font leur entrée dans le Petit Robert : adénomyose, biomédicament, neurodiversité, périménopause ou encore la prep.
7. microagression
Formée à l’aide du préfixe grec micro-, qui signifie « petit », la microagression est une agression qui passe souvent inaperçue. Là où l’agression est une attaque violente et indiscutable, la microagression est un acte ou un propos d’apparence banale, généralement dénué de malveillance, et n’existe que si cet acte ou ce propos sont perçus comme discriminants par la personne visée. Les remarques liées à l’apparence physique, à l’origine ethnique supposée, à l’accent, etc., peuvent constituer des microagressions.
Certains comparent la microagression à une goutte d’eau qui vous tombe sur la tête : cela peut être désagréable, mais vous n’êtes même pas mouillé. En revanche, si des centaines de gouttes d’eau vous tombent dessus l’une après l’autre, vous finissez trempé.
Citons quelques autres mots évoquant des thèmes de société qui font leur entrée dans le Petit Robert : cagnotter, chemsex, débunker, démission silencieuse, deuil blanc, justice restaurative, néobanque, soumission chimique ou encore le bien-vieillir.
6. kamishibaï
Connaissez-vous l’art du kamishibaï ? Originaire du Japon, il consiste à conter une histoire en faisant défiler des planches illustrées dans un théâtre portatif. Depuis quelques années, le kamishibaï se développe en France, notamment à travers des « lectures » de kamishibaïs pour les jeunes enfants dans les crèches, les écoles, les médiathèques… Certains albums pour la jeunesse écrits en France sont désormais déclinés en kamishibaïs et vendus dans les librairies.
Ce mot directement emprunté au japonais (comme, avant lui, manga, karaoké ou encore kamikaze) nous donne aussi l’occasion d’apprendre qu’en japonais, kami signifie « papier » et shibaï, « théâtre ».
Citons quelques autres mots de la culture et du sport qui font leur entrée dans le Petit Robert cette année : drag, gravel, muay-thaï, skicross ou encore VAR (assistance vidéo à l’arbitrage).
5. hallucination
Retour dans le domaine de l’intelligence artificielle, avec un mot né au XVIIe siècle mais qui a récemment vu son sens s'enrichir : hallucination.
Ce terme médical désigne à l’origine la perception pathologique et régulière de faits, d’objets qui n’existent pas ou de sensations en l’absence de tout stimulus extérieur (comme le fait d’entendre des voix ou d’avoir des visions). Par extension, hallucination désigne également dans la langue courante toute erreur des sens (par exemple le fait de croire avoir vu quelqu’un alors que ce n’était pas lui, ou d’avoir entendu le téléphone sonner alors que non).
Mais lorsque l’IA se met à halluciner, peut-il s’agir d’une erreur des sens ? Impossible, puisque la machine, qui n’est pas un être vivant, n’est douée d’aucune sensibilité. On est là face à une erreur de calcul, à un bug. Conséquence : l’article hallucination du Petit Robert se voit enrichi d’un nouveau sens : « Réponse fausse produite par une intelligence artificielle générative, avec une apparence de vérité. »
4. zaatar
Très prisé au Liban, mais également en Syrie et sur toute la côte est de la Méditerranée, ce mélange d’épices et d’herbes séchées est aussi de plus en plus populaire en Europe. Le mot zaatar est cependant un peu facétieux. Emprunté à l’arabe za‘tar, qui signifie « thym », il désigne à l’origine le thym, mais aussi d’autres plantes aromatiques de la même famille, comme l’origan ou l’hysope. Pour réaliser le condiment, qui s’appelle lui aussi zaatar, on utilise généralement des graines de sésame torréfiées, du sumac, du sel, et bien sûr du zaatar ! Thym, origan ou hysope, c’est donc selon les goûts.
Un peu comme dans la chakchouka, une autre préparation culinaire qui fait son entrée dans le Petit Robert : composée d’œufs et de légumes cuits à l’huile (tomates, piments, poivrons, oignons…), cette recette aussi connaît des variations selon les cuisiniers, pour le plus grand bonheur de nos papilles !
3. pelleteux de nuages
On connaissait déjà le pelleteur, l’ouvrier qui effectue des travaux pour enlever de la terre, des gravats, voire de la neige… Mais avez-vous déjà essayé d’attraper des nuages avec une pelle ? Au Québec, un pelleteur ou pelleteux de nuages (pelleteuse de nuages au féminin) est une personne qui perd son temps à échafauder des projets irréalisables – un rêveur ou une rêveuse, en somme. Cette expression poétique, courante au Québec, n’est pas sans rappeler une expression synonyme autrefois employée dans le reste de la francophonie, tombée en désuétude : assembleur de nuées. Chiche de l’employer dans votre prochaine conversation ?
Citons quelques autres mots de la francophonie qui font leur entrée dans le Petit Robert : encommissionner (Belgique), carac (Suisse), balado et cône orange (Québec), benzine au sens de « pédale d’accélérateur » (Liban)…
2. mon gâté
En 2020, le succès phénoménal de la chanson Bande organisée, avec en ouverture le fameux « Oui ma gâtée » du rappeur marseillais SCH, a donné au mot une visibilité exceptionnelle dans toute la France. Employé à Marseille depuis plusieurs décennies, mon gâté (au féminin ma gâtée) est un terme d’affection que l’on emploie pour s’adresser à une personne que l’on aime d’amour ou d’amitié. Exactement comme mon chéri, ma chérie. Les Marseillais se souviendront que Nana, la plus célèbre des poissonnières du Vieux-Port, l’utilisait pour s’adresser à ses clients. En tout cas, cinq ans après le fameux couplet de SCH, gâté est aujourd’hui compris et employé dans toute la France, en particulier chez les adolescents et jeunes adultes, ce qui justifie son entrée dans le Petit Robert.
À noter que l’on retrouve également ce gâté en… créole réunionnais, où il est employé uniquement au masculin, même pour désigner une femme.
Mais gâté n’arrive pas seul, puisque deux autres mots emblématiques de la région de Marseille font cette année leur entrée dans le Petit Robert : le verbe tanquer et l’adverbe tarpin.
1. dinguerie
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, dinguerie n’est pas un mot nouveau : il s’agit plutôt d’un mot ressuscité. Attesté pour la première fois dans les années 1920, il désigne alors le caractère d’une personne, d’un comportement dingue, ou bien une action réalisée par une personne dingue. En somme, c’est un synonyme familier de folie, avec une connotation plutôt péjorative. À la fin des années 2010, ce mot dont l’usage restait jusque-là limité est repris par la jeune génération et largement diffusé via les réseaux sociaux, jusqu’à atteindre des pics de fréquence ces deux dernières années. Cependant, sa signification a évolué : une dinguerie est aujourd’hui quelque chose d’incroyable, en bonne ou en mauvaise part (une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux est une dinguerie, une mésaventure est aussi une dinguerie). Dinguerie peut aussi être synonyme du sens figuré de tuerie (dont le sens originel est également négatif), pour désigner quelque chose d’excellent : « ce gâteau, c’est une dinguerie ! »
L’article dinguerie du Petit Robert, qui existait depuis plusieurs décennies, est donc actualisé avec ces nouvelles significations. Parce qu’une fois qu’un mot est inscrit noir sur blanc dans le dictionnaire, sa définition n’est pas figée pour toujours, et heureusement ! Elle continue d’évoluer avec le sens du mot.
Citons quelques autres mots familiers qui font cette année leur entrée dans le Petit Robert : l’adjectif chill, l’expression c’est carré ou encore pister au sens de « comprendre ».
*
Si ce bref tour d’horizon des nouveautés de l’édition 2026 vous a donné envie d’en savoir plus sur la manière dont sont choisis les mots du Petit Robert, je vous invite à lire le billet de blog dédié.
Et pour découvrir les femmes et les hommes qui travaillent à l’actualisation de votre dictionnaire, c’est ici.
......................................................................................................................................................
Retrouvez tous ces mots et sens nouveaux ainsi que des centaines d’articles actualisés dans la toute nouvelle édition du Petit Robert de la langue française (en version imprimée et numérique), mais aussi sur Dico en ligne Le Robert, le dictionnaire gratuit pour tous.