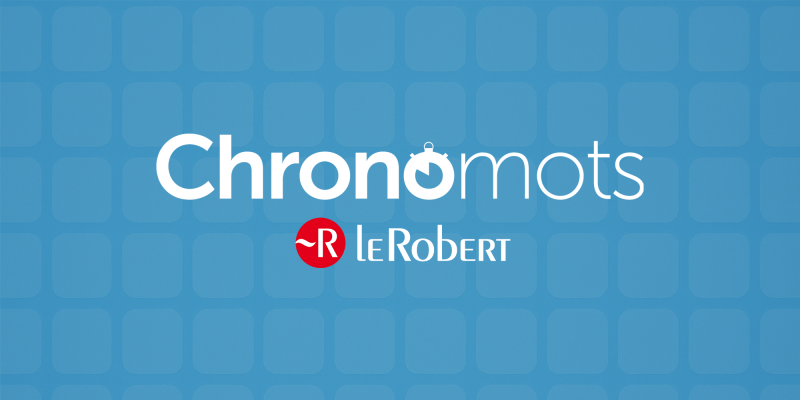chènevière
définition
Définition de
chènevière
nom féminin
Champ où croît le chanvre. ➙ régional cannebière.
exemples
Phrases avec le mot chènevière
Ils achetèrent une chènevière, puis, un peu plus tard, un petit pré pour la vache.Zulma Carraud (1796-1889)
Ses lopins de bois d'aulne et de chènevière ont une étendue comparable de 14 setiers.Histoire et Sociétés Rurales, 2010, Ghislain Brunel (Cairn.info)
Il ne faudra pas longtemps pour qu'elle fasse un bon jardin et une bonne chènevière.Zulma Carraud (1796-1889)
Avec les aulnaies et la chènevière, il est vraisemblable que ses biens fonciers se montent à une quarantaine de livres maximum.Histoire et Sociétés Rurales, 2010, Ghislain Brunel (Cairn.info)
Derrière chaque maison sont des près et des chènevières.Alfred Assollant (1827-1886)
De riches chènevières disputaient les bords de l'eau à des prairies, dont la verdure épaisse attestait la fertilité.Charles de Bernard (1804-1850)
Elle suivit son guide dans un sentier tout humide de la rosée du soir, jusqu'à l'entrée d'une chènevière dont un fossé formait la clôture.George Sand (1804-1876)
Elle possédait une petite maison avec une petite chènevière et un jardin planté de pommiers, de pruniers et de groseilliers.Zulma Carraud (1796-1889)
Les chènevières semblaient de cette pâtée d'orties qu'on donne aux dindons ; les vignes et les arbres étaient hachés, les jardins saccagés ; tout ce qui était sorti de terre était perdu.Eugène Le Roy (1836-1907)
Ces exemples proviennent de sites partenaires externes. Ils sont sélectionnés automatiquement et ne font pas l'objet d'une relecture par les équipes du Robert. En savoir plus.
Dictionnaire universel de Furetière (1690)
Définition ancienne de CHENEVIERE s. f.
Lieu semé de chenevi pour faire venir du chanvre. Espouvantail de cheneviere, est un fantôme habillé en homme, pour épouvanter les oiseaux qui veulent venir manger le chenevi. En Latin cannabaria, ou chabanaria. On appelle figurément une personne fort laide & propre à faire peur, un épouvantail de cheneviere.
On le dit aussi d'une terreur mal-fondée qu'on nous veut donner, qui en apparence feroit du mal, mais qui n'en fait point en effet quand elle est bien examinée.
Ces définitions du XVIIe siècle, qui montrent l'évolution de la langue et de l'orthographe françaises au cours des siècles, doivent être replacées dans le contexte historique et sociétal dans lequel elles ont été rédigées. Elles ne reflètent pas l'opinion du Robert ni de ses équipes. En savoir plus.