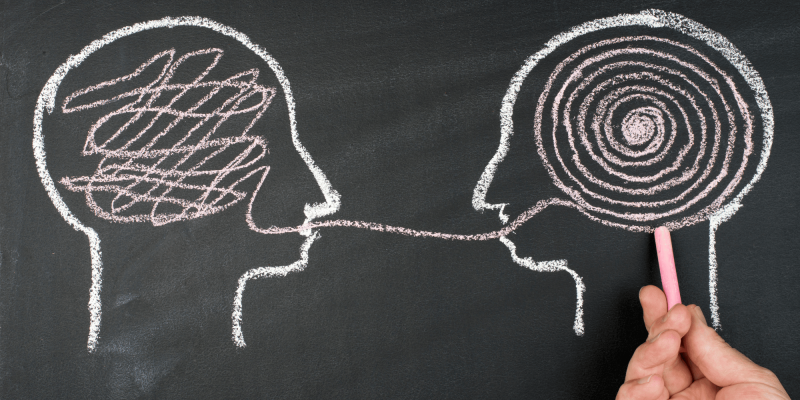Derrière la mélodie, les rimes et l’émotion, la chanson française cache parfois quelques dérapages grammaticaux qui titillent l’oreille. Oui, même Véronique Sanson, Barbara et Étienne Daho ont quelques comptes à régler avec la langue française. Mais attention : avant de sortir les fourches (et le Guide facile pour ne plus faire de fautes !), rappelons que la « faute », précipitation en studio mise à part, est souvent consciente.
Entre le besoin de faire rimer, l’effet de style ou tout simplement la liberté que s’accordent les artistes, les raisons sont légion. La faute de français est parfois même volontaire et assumée pour la création : c’est ce qu’on appelle la licence poétique. Parmi les erreurs les plus fréquentes, les accords de participes passés qui s’affranchissent des règles, les prépositions qui se baladent, les liaisons douteuses et les conjugaisons inventées se voient déjà en haut de l’affiche. Sans oublier l’orthographe fantaisiste. Mais, après tout, la chanson n’est-elle pas aussi un art de la transgression ?
Plongeons ensemble dans ce florilège musico-grammatical en dix pépites, avec bienveillance et humour, car, au fond, ces petites entorses à la langue de Molière font partie du charme de nos chansons préférées !
10. « Je fais ce que j’ai envie » (Véronique Sanson)
Dans Chanson sur ma drôle de vie, Véronique Sanson malmène la langue française plutôt deux fois qu’une. D’abord avec « je fais ce que j’ai envie », puis « on fait ce qu’on a envie ». Normalement, avoir envie implique la préposition de : on dit « ce que j’ai envie de faire ». La construction correcte ici serait donc « je fais ce dont j’ai envie », dont reprenant un groupe nominal précédé de la préposition de. Mais, reconnaissons-le, quelle meilleure façon de suivre ses caprices sans se plier aux règles que de dire « je fais ce que j’ai envie » ?
9. « J’ai laissé sur une planisphère » (Laurent Voulzy)
Laurent Voulzy nous emmène en voyage dans sa chanson Le cœur grenadine... mais fait une petite escale grammaticale ! Si le mot planisphère est masculin, Laurent Voulzy l’utilise au féminin. L’erreur est compréhensible : avec ce suffixe en -sphère, on pense instinctivement au féminin sphère. Mais non, même si la logique n’est pas au rendez-vous, c’est bien un planisphère, au même titre qu’un hémisphère d’ailleurs. Une petite confusion que l’on mettra sur le dos de la mélancolie du chanteur.
8. « Chiens en plein mois d’août, largués sur un autoroute » (Louis Chédid)
Dans son titre Tu M’Aimes Plus (qui fait déjà l’économie du ne de la négation), Louis Chédid nous parle d’abandon avec un petit écart : cette fois, c’est autoroute qui devient soudainement masculin. Une autre faute de genre dans la lignée de Laurent Voulzy ? Plutôt un archaïsme : même s’il est vrai que le masculin ne se rencontre plus, on en trouvait des exemples autrefois.
7. « De l’ombre ou de la lumière, lequel des deux nous éclaire ? » (Calogero)
C’est une question philosophique que nous pose Calogero dans L’ombre et la lumière, avec un pronom interrogatif qui laisse un peu perplexe. Faute d’inattention ou volonté d’attirer l’attention ? En tout cas, quand on hésite entre deux noms féminins (ombre et lumière), on attendrait laquelle plutôt que lequel. À moins que l’artiste n’ait cherché à préserver la musicalité de sa phrase ?
6. « Une gloire déchue des folles années trente avait mis T’aux enchères » (Barbara)
Au grand dam des puristes, la grande dame de la chanson française nous livre une liaison douteuse dans Drouot avec le vers « avait mis aux enchères parmi quelques brocantes », prononcé « mis T’aux enchères ». Mais où est le t sur le papier ? Mystère. Un effet poétique vite pardonné, un bel exemple de licence artistique chez une artiste que l’on ne peut certainement pas soupçonner de manquer de culture linguistique ou littéraire. Son roman préféré ? Sans doute Les Liaisons dangereuses de Laclos.
5. « C’est la fête, c’est psychadélique, me demande pas c’que j’fabrique » (Étienne Daho)
Tombé pour la France… ou pour la langue française ? Serait-ce sous l’effet d’hallucinogènes que l’adjectif psychédélique se retrouve affublé d’une lettre a dans sa chanson ? On n’va pas lui d’mander c’qu’il fabrique, il nous répondrait n’importe quoi : « j’en sais rien », nous lance-t-il lui-même en chantant. Daho, des hauts et des bas : une voyelle peut être prise pour une autre, personne n’est à l’abri. L’essentiel, c’est que ça sonne bien !
4. « T’façon si y aurait pas d’balance, y aurait personne en prison » (Sniper)
Un bon sniper vise toujours juste. Dans le morceau La France, le groupe de rap Sniper nous livre un concentré authentique de français parlé avec une construction grammaticale audacieuse. La règle est bien connue : après si, jamais le conditionnel mais l’indicatif. La phrase correcte serait donc « s’il n’y avait pas de balance ». Mais priorité à la langue orale et populaire : l’expression prime sur la norme. Dans l’univers du rap, ce code fait partie de l’identité artistique.
3. « Il l’a pris dans ses bras car elle avait un peu froid » (Indochine)
Les paroles du groupe Indochine sont souvent bien énigmatiques. Parfois, il nous faudrait un interprète. Parfois, plutôt un correcteur. Dans Trois nuits par semaine, il aurait fallu accorder le participe passé prise avec le complément d’objet direct l’, celui-ci étant placé avant le participe et faisant référence à une femme. Heureusement, l’émotion de la chanson reste intacte malgré ce léger accroc grammatical, qui s’explique sans doute par le rythme de la phrase.
2. « Dès que le vent soufflera, je repartira » (Renaud)
Enfant terrible de la chanson française, Renaud nous régale d’une conjugaison très personnelle. C’est bien sûr pour la rime qu’il fait suivre soufflera de repartira (au lieu de repartirai). Et c’est par souci de cohérence qu’il enchaîne avec « dès que les vents tourneront, nous nous en allerons ». Nous, nous n’irons pas le critiquer sur le terrain de la langue, qu’il fait si bien vivre. Disons-le clairement : c’est pas l’homme qui fait la faute, c’est la faute qui fait l’homme !
1. « C’est à l’amour auquel je pense » (Françoise Hardy)
Icône incontestable de la chanson française, Françoise Hardy écorche les oreilles des grammairiens avec son titre C’est à l’amour auquel je pense. On dit soit « c’est à l’amour que je pense », soit « c’est l’amour auquel je pense », sans cumuler à et auquel. Cette tournure a beau être fautive, elle crée un effet d’insistance qui n’est pas sans déplaire et qui se marie bien avec l’intensité émotionnelle des paroles.
Comme tout art vivant, la chanson française entretient un rapport créatif et parfois tumultueux avec la langue. Entre élans poétiques et contraintes musicales, les artistes s’accordent certaines libertés avec les normes. Faut-il pour autant leur jeter la pierre ? Certainement pas, car ce sont ces petites libertés qui participent au charme et à l’authenticité de leurs morceaux. La chanson populaire a toujours été un laboratoire linguistique, un lieu d’expérimentation où se forgent de nouveaux usages. Alors, continuons à fredonner ces refrains imparfaits avec plaisir. Après tout, comme le chantait si justement Aznavour, « il faut savoir encore sourire »… Lui qui nous disait aussi « mes emmerdes étaient ceux de notre âge ». Vous voyez la faute ?
Crédit : mactrunk/iStock