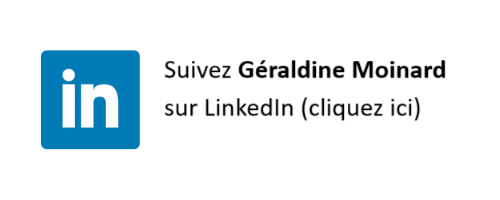Que désigne la sellette dans cette expression ? Pour vous éclairer, Le Robert vous emmène dans les tribunaux d’avant la Révolution française avec le podcast La Puce à l’oreille de Lucie Bouteloup sur RFI.
Que signifie l’expression être sur la sellette ?
L’expression être sur la sellette signifie surtout aujourd’hui « être dans une position fragile ». Par exemple, quand la presse titre : « Le Premier ministre est sur la sellette », c’est qu’il risque de devoir quitter son poste. On peut aussi l’employer avec un inanimé : si des subventions sont sur la sellette, c’est qu’elles pourraient être supprimées.
Mais cette expression a aussi d’autres sens, plus anciens et un peu moins fréquents de nos jours : celui d’« être accusé dans un procès » ou encore d’« être interrogé à la manière d’un accusé ». On dit d’ailleurs mettre ou tenir quelqu’un sur la sellette pour signifier qu’on le bombarde de questions.
Quelle est l’origine de l’expression être sur la sellette ?
Le mot sellette, dérivé de selle, a été formé au XIIIe siècle avec le suffixe diminutif -ette. Tout comme une maisonnette est une petite maison, une sellette est une petite selle.
Ce n’est toutefois pas la selle d’équitation ou de vélo que l’on imagine aujourd’hui. À l’origine, le mot selle désigne un petit siège de bois sans dossier, une sorte de tabouret. (C’est d’ailleurs de ce sens de « siège » que vient l’expression aller à la selle, qui signifie « aller aux toilettes », les latrines consistant initialement en un siège de bois percé.) La sellette est un petit siège plus bas que la selle, sur lequel on faisait autrefois asseoir l’accusé lors d’un procès. C’est pourquoi le sens premier d’être sur la sellette est « être accusé dans un procès ».
Dès le XIVe siècle, l’expression prend aussi le sens figuré de « être soumis à un interrogatoire » (comme l’accusé durant son jugement) puis, à partir de la fin du XVIe siècle, celui de « être soumis au jugement d’autrui », c’est-à-dire en attente d’une condamnation morale (et pas forcément juridique). De la condamnation morale à la destitution, il n’y a qu’un pas. C’est pourquoi celui ou celle qui est sur la sellette est aujourd’hui dans une position fragile, en attente de renvoi ou de révocation.
Quels sont les synonymes de être sur la sellette ?
Une autre expression signifiant « être soumis au jugement d’autrui » trouve elle aussi son origine dans les tribunaux : être au banc des accusés – la sellette ayant cédé la place à un simple banc après la Révolution française. Quant à l’expression être cloué au pilori, elle évoque également l’opprobre public associé à une condamnation. On peut dire aussi, en un seul mot, que l’on est accusé, attaqué ou incriminé.
Pour exprimer l’idée d’être criblé de questions, on peut dire que l’on est cuisiné ou mis sur le gril, deux expressions qui font elles aussi référence à une position inconfortable… voire brûlante !
Enfin, la position fragile évoque un autre siège : le siège éjectable !
Pour en savoir plus, vous pouvez écouter le podcast de La Puce à l’oreille consacré à cette expression sur le site de RFI.
Géraldine Moinard, lexicographe et directrice de la rédaction
Crédit photo : claudenakagawa/iStock