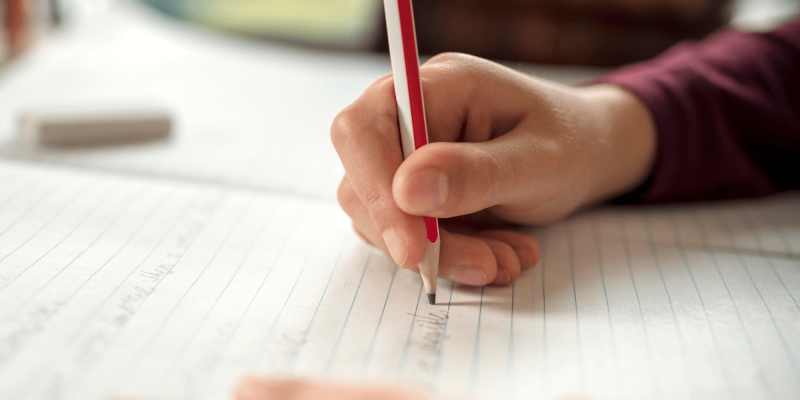
La grammaire, c’est comme un livre de cuisine : quand on débute aux fourneaux, on ne quitte pas la recette des yeux ; une fois le plat maîtrisé, on laisse l’ouvrage prendre la poussière. Complément circonstanciel, adverbe, conjonction de coordination… ces mots de la cuisine grammaticale, vous les avez appris par cœur, peut-être dans la douleur, puis vous les avez probablement oubliés. Mais au Robert, on ne laisse pas les mots au placard ! Il est temps de rouvrir vos cahiers d’école et d’y découvrir des saveurs d’antan insoupçonnées. C’est parti pour un top 10 qui vous mettra les mots à la bouche !
10. adverbe
Commençons par un classique, aussi incontournable que la cuisson des pâtes ! Un adverbe est un mot toujours invariable qui modifie le sens d’un autre mot, que ce soit un adjectif (c’est très bon : on intensifie bon), un verbe (j’aime beaucoup la cuisine italienne : on intensifie aimer), ou même d’une phrase complète (je suis toujours d’accord pour un dessert : on rend l’affirmation permanente). Il apporte nuance et relief à vos phrases, comme les épices à vos plats. Vous pouvez les limiter (au risque de perdre en précision) ou les multiplier (au risque d’alourdir votre texte). C’est une question de dosage !
9. conjonction de coordination
Enfant, vous avez peut-être souffert avec cette longue suite de syllabes comme avec les grumeaux de la pâte à crêpes. Les conjonctions de coordination relient des éléments de même nature : deux noms (le chocolat et la vanille), deux adjectifs (c’est sucré ou salé), deux phrases (ces lasagnes sont délicieuses car c’est la recette de ma grand-mère)… Vous les avez peut-être mémorisées grâce à la célèbre phrase Mais où est donc Ornicar ?, qui correspond à mais, ou, et, donc, or, ni et car. Mais cette liste s’est récemment vu priver d’un ingrédient, donc, recatégorisé en adverbe par les grammairiens. Heureusement, notre cher Ornicar est toujours là !
8. préposition
Notre ami Ornicar a peut-être fait remonter en vous le souvenir d’une autre formule magique : à deux parts pour cent (ou l’une de ses variantes). Cette formule permet de mémoriser les prépositions à, de, par, pour et sans… Mais il en existe bien d’autres : dans, en, vers, avec, sous, contre, sauf, chez, parmi, entre, près de, au lieu de, etc. Les prépositions introduisent le complément d’un verbe, d’un nom, d’un adjectif… Leur emploi peut sembler naturel, mais il est souvent arbitraire. Par exemple, pour indiquer la possession, on utilise de dans c’est le cookie de ton frère mais à dans ce cookie est à ton frère. De quoi s’emmêler les pinceaux !
7. complément circonstanciel
Les prépositions introduisent un complément, mais qu’est-ce qu’un complément ? C’est un élément qui apporte des informations supplémentaires. Il en existe plusieurs types ; voyons ensemble le complément circonstanciel (aussi appelé complément de phrase). Il précise les circonstances de l’action : le lieu (je mange une glace à la pistache sur la plage), le moment (je mange un gâteau au chocolat après le repas), le but (je bois un milkshake pour le plaisir), le moyen (je mange du riz avec des baguettes), etc. Il est très souple ! On peut le déplacer, le supprimer, le modifier, et même le cumuler avec d’autres, en user et en abuser : sur la plage, face à la mer, par pure gourmandise, je mange (avec les doigts, certes, mais avec délicatesse) un éclair à la vanille après le repas, au coucher du soleil. C’est comme la matière grasse dans un plat : si on n’en met pas, c’est un peu sec ; si on en met trop, c’est indigeste !
6. COD
Impossible de parler des compléments sans évoquer trois lettres qui ont donné des sueurs froides à beaucoup d’entre nous : COD, pour « complément d’objet direct ». Complément car le COD complète toujours un verbe, et direct car il n’est jamais introduit par une préposition. Pour le trouver, on pose la question qui ? ou quoi ?. Exemple : j’adore le tiramisu !. J’adore quoi ? Réponse : le tiramisu. Le tiramisu est donc le COD de la phrase. Et quand on parle de COD, la règle de l’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir n’est jamais loin ; le cauchemar de nombre d’élèves !
5. verbe intransitif
Pour esquiver la question du COD, vous pouvez toujours employer un verbe intransitif. Un verbe intransitif n’a jamais de complément d’objet, comme dormir ou venir (on ne peut pas dire il dort quoi ? ni il vient quoi ?). À l’inverse, un verbe transitif peut (ou doit) en avoir un, comme boire (je bois un smoothie) ou offrir (j’offre une boîte de chocolats).
4. verbe pronominal
Pour parfaire notre omelette aux verbes, ajoutons les verbes pronominaux. Ils se conjuguent avec un pronom réfléchi, c’est-à-dire un pronom qui renvoie au sujet du verbe. Par exemple, dans l’enfant se régale, le pronom se fait référence à l’enfant, qui est le sujet du verbe. Le saviez-vous ? Aux temps composés, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l’auxiliaire être (je me suis régalée), et leurs règles d’accord du participe passé sont particulièrement complexes ! Si vous vous sentez d’attaque pour l’omelette soufflée, nous vous expliquons la règle sur Dico en ligne Le Robert.
3. proposition subordonnée
Une phrase contient généralement un ou plusieurs verbes conjugués, et chaque partie de la phrase contenant un verbe est appelée proposition. Parfois, une proposition dépend d’une autre (c’est-à-dire qu’elle n’a pas de sens sans l’autre) ; on dit alors qu’elle lui est subordonnée. Par exemple, dans la tarte aux pommes que j’ai faite est délicieuse, la proposition que j’ai faite dépend de la proposition la tarte aux pommes est délicieuse. Et puisqu’il est toujours possible de relever un plat, souvenez-vous que, parmi les subordonnées, il y a les subordonnées relatives, qui complètent un nom (le crumble que je déguste est encore tiède), et les subordonnées conjonctives (ou complétives), qui complètent un verbe (vous devinez que je suis gourmande).
2. antécédent
Vous savez répondre à la question « Quels sont vos antécédents médicaux ? » Mais en grammaire, vous souvenez-vous de ce qu’est un antécédent ? Là aussi, il y a un rapport avec ce qui vient avant : une proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif (qui, que, quoi, dont, où…), qui a généralement un antécédent : le nom que la subordonnée relative complète. Trop abstrait ? Quittons le cabinet médical et retournons aux fourneaux : dans la tartine que j’ai trempée dans mon chocolat chaud, le pronom relatif que a pour antécédent la tartine. Et connaître l’antécédent permet d’accorder correctement… le participe passé ! Décidément, vous n’y échapperez pas.
1. adjectif épithète détaché
Ce terme est peut-être le plus effrayant de ce top mais, en réalité, il est simple comme un œuf à la coque ! L’adjectif épithète détaché (ou adjectif apposé) ne vient pas directement avant ou après ce qu’il qualifie, c’est pour cette raison qu’il est dit détaché. Il est placé en début ou en fin de phrase (fourrés à la crème, les choux sont encore meilleurs), ou bien séparé par des virgules (la mousse au chocolat, légère, était un vrai délice). Mais attention ! Même éloigné du nom qu’il qualifie, il s’accorde toujours avec lui : la tarte tatin avait été sortie du four et trônait désormais sur le plan de travail, fumante.
Cette petite révision vous a donné faim… de connaissances ? Vous avez soif d’en savoir encore plus ? Vous êtes même prêt à dévorer les règles d’accord du participe passé ? N’hésitez pas à consulter les fiches de grammaire de Dico en ligne Le Robert. Rassurez-vous, il n’y a pas d’interro demain !
Crédit photo : Brian A Jackson/Shutterstock






