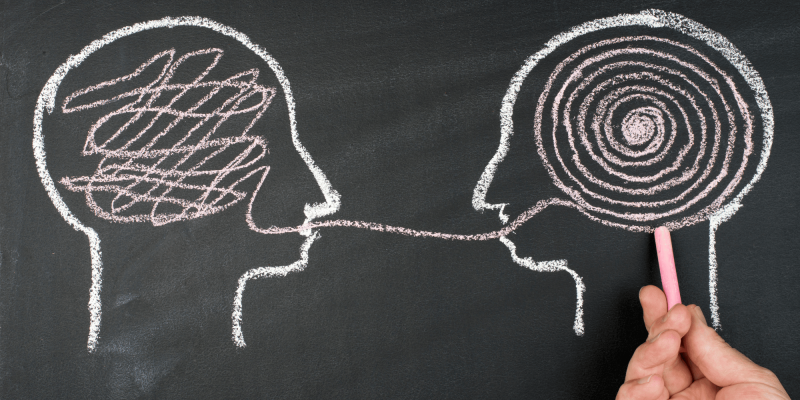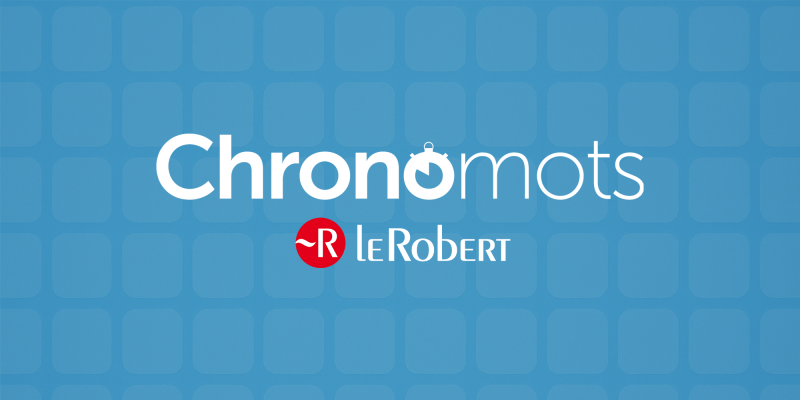morveux
définition
synonymes
Synonymes de morveux, morveuse nom
gamin, bambin, bébé, chérubin, diablotin, enfant, petit, petit diable, tête blonde (souvent au pluriel), gosse (familier), lardon (familier), loupiot (familier), marmot (familier), mioche (familier), môme (familier), mouflet (familier), moutard (familier), titi (familier), gone (familier, régional), minot (familier, régional), pitchoun (familier, régional), minouchet (familier, vieux), mômichon (familier, vieux), mômignard (familier, vieux), mômillon (familier, vieux), chiard (familier, péjoratif), galopin (familier, péjoratif), morpion (familier, péjoratif), têtard (familier, péjoratif), merdeux (très familier, péjoratif), miston (argot), garnement (péjoratif), [fille] petite fille, fillette, [garçon] petit garçon, garçonnet, marmouset
exemples
Phrases avec le mot morveux
Laids, mal venus, morveux, petits voyous, grands affamés !Gustave Coquiot (1865-1926)
Longtemps, bien longtemps le bébé n'a été qu'un morveux.Spirale, 2020, Patrick Ben Soussan (Cairn.info)
Il s'agit probablement d'une lymphangite ou d'une angéioleucite, analogue aux cordes farcineuses qui se dessinent sous la peau des animaux morveux.Charles Anglada (1806-?)
Aussi, la police interdisait et punissait la vente de chevaux morveux afin d'endiguer la propagation de ce fléau mortel.Dix-huitième siècle, 2021, Élisabeth Rochon (Cairn.info)
Il existe un proverbe qui dit «qui se sent morveux se mouche».Europarl
Il était tout morveux, ses vêtements crasseux et en lambeaux.Études Tsiganes, 2020, Elisabeth Clanet dit Lamanit (Cairn.info)
On ramassait des assassins de quinze ans, et des morveux sans poils s'appelaient « hommes de lettres ».Marc Elder (1884-1933)
Si ce n'est pas à lui allonger des claques, un morveux qui devrait être encore au collège !Émile Zola (1840-1902)
Je vous ai mouché, morveux, et je vous moucherai encore.Victor Hugo (1802-1885)
Bien sûr, les petits étaient toujours baveux, morveux, ils courraient partout, mais ils écoutaient, ils savaient se tenir, ils étaient étonnants.Spirale, 2005, Michèle Gentelet (Cairn.info)
Il a été un lanceur de défis aux psychanalystes et, plus souvent qu'à son tour, il a fait les psychanalystes se sentir morveux.La Cause du désir, 2008, Jacques-Alain Miller (Cairn.info)
Il a généralement le nez morveux, et paraît prendre plaisir à se le frotter avec la langue.Jean-François de La Harpe (1739-1803)
Il n'observe pas assez les distances ; il témoigne vraiment trop de tendresse à ce morveux.Georges Eekhoud (1854-1927)
J'excuserais encore un jeune homme, un petit morveux, se laissant emballer par les utopies.Marcel Proust (1871-1922)
Nous voulons couper l'herbe sous le pied de ces morveux et nous désirons établir tout de suite et pour toujours ce qu'il faudra qu'ils pensent de nous.Les temps modernes, 2006, Benoît Denis (Cairn.info)
C'était très douloureux pour mon petit orgueil de morveux de l'époque.L'année psychologique, 2018, Michel Hessel (Cairn.info)
Que si tu me parles encore sur ce ton, c'est à la barrette que je parlerai, morveux !Eugène Demolder (1862-1919)
Tiens, ne sois pas bête, reprit-elle ; qui parle de le maltraiter, ce morveux !Lucien Biart (1828-1897)
Ce morveux ne s'inquiétait pas plus de sa mère que s'il n'en avait jamais eu.Fortuné du Boisgobey (1821-1891)
Afficher toutRéduire
Ces exemples proviennent de sites partenaires externes. Ils sont sélectionnés automatiquement et ne font pas l'objet d'une relecture par les équipes du Robert. En savoir plus.
Dictionnaire universel de Furetière (1690)
Définition ancienne de MORVEUX, EUSE adj.
Qui a de la morve qui luy pend au nez. Et on appelle aussi les enfans par mespris, de petits morveux. On appelle aussi des chevaux morveux. En Latin mucosus. On dit proverbialement, qu'il vaut mieux laisser son enfant morveux, que de luy arracher le nez, pour dire, qu'il vaux mieux souffrir un petit mal, que de l'augmenter par le remede.
Ces définitions du XVIIe siècle, qui montrent l'évolution de la langue et de l'orthographe françaises au cours des siècles, doivent être replacées dans le contexte historique et sociétal dans lequel elles ont été rédigées. Elles ne reflètent pas l'opinion du Robert ni de ses équipes. En savoir plus.